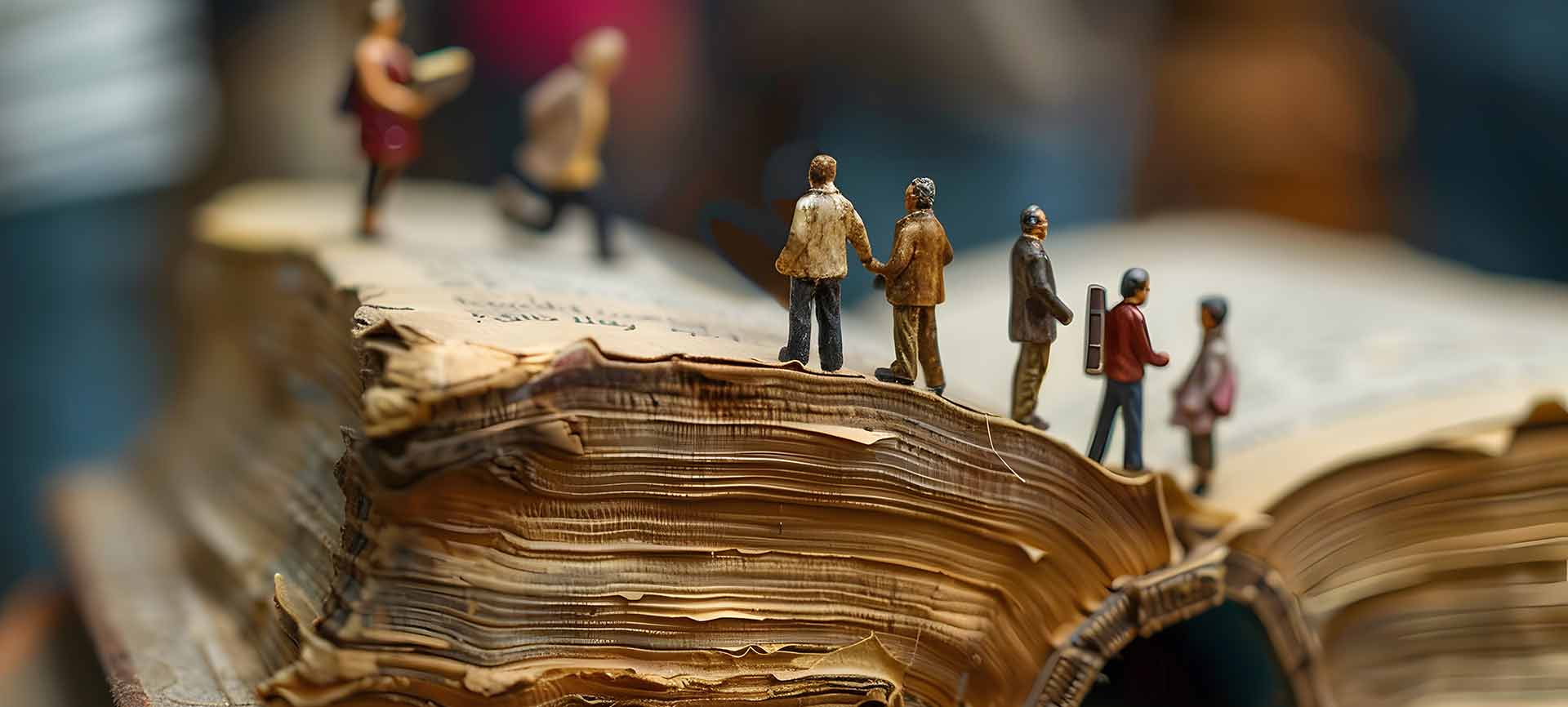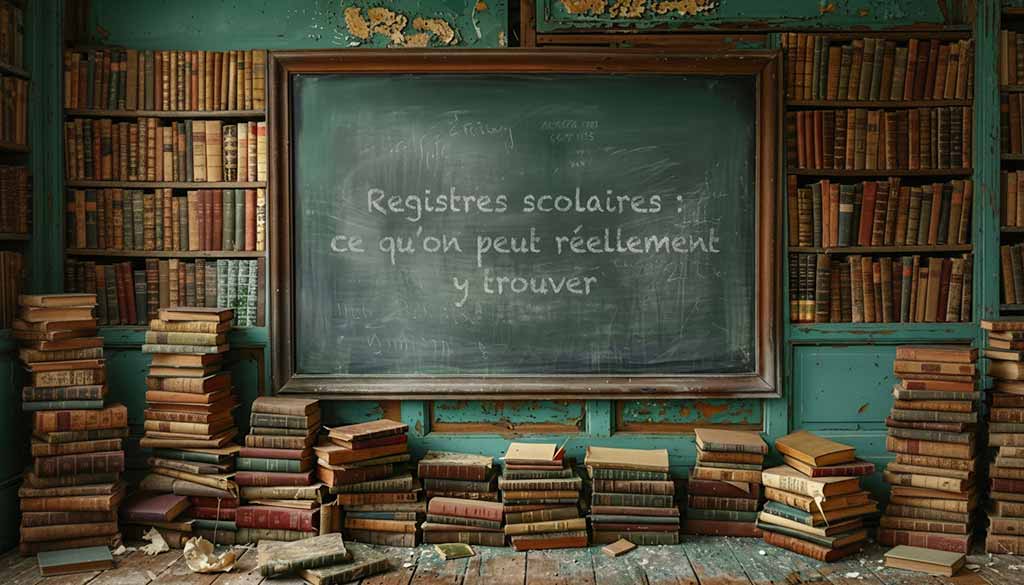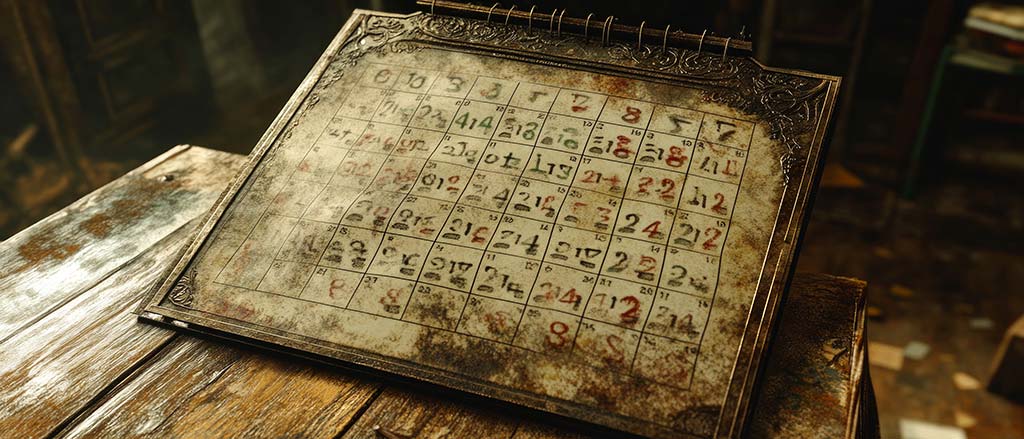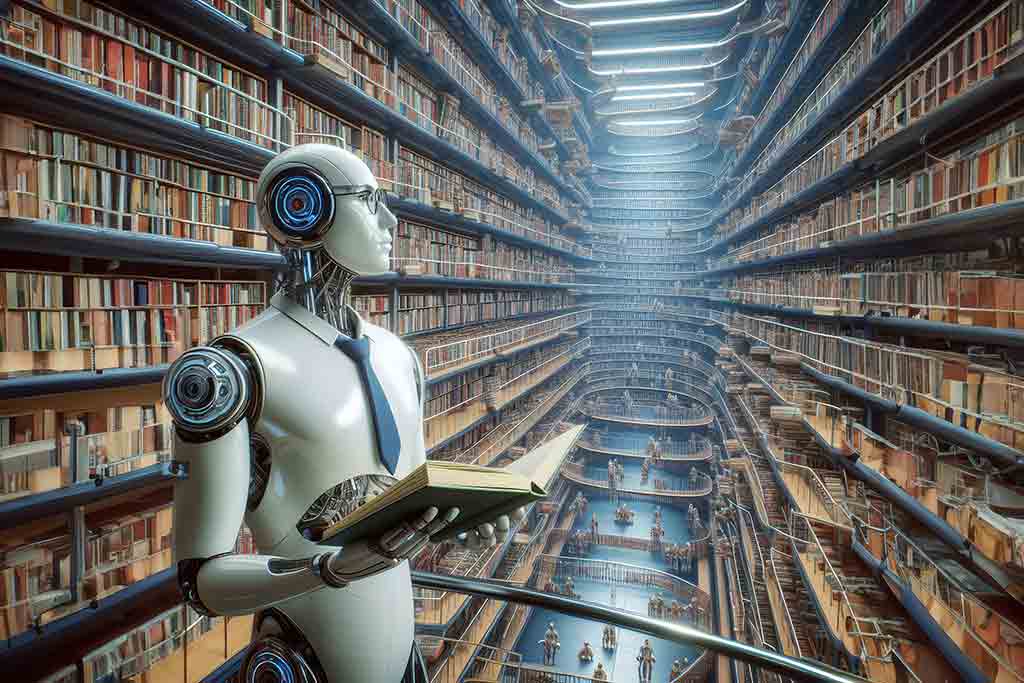Il arrive fréquemment, au détour d’un registre ancien, de tomber sur une mention surprenante : un ancêtre identifié uniquement par son prénom ou un qualificatif, sans nom de famille fixé. Ce phénomène, loin d’être marginal, traduit l’évolution progressive de l’usage du patronyme en France et en Europe.
Cet article propose de comprendre ces situations, d’en explorer les contextes et d’identifier les méthodes de recherche pour dépasser ces blocages.
I. Des identités mouvantes à travers l’histoire
1.1 Quand le prénom suffisait à identifier
Au haut et bas Moyen Âge, l’usage exclusif du prénom était courant. Dans des communautés restreintes, il suffisait pour désigner un individu. Lorsque la confusion menaçait, on ajoutait un sobriquet, une indication de métier ou une origine géographique : Johannes Pistor (Jean le boulanger), Petrus de Ponte (Pierre du Pont).
Ces surnoms vont souvent se pérenniser en étant transmis à la génération suivante : les noms de famille sont nés ! La croissance démographique et donc la multiplication des individus à nommer constituent un facteur favorable à cette mutation.
📌 À savoir :

Cartulaire de l’église Notre-Dame de Paris

Cartulaire de l’abbaye de Saint-Bertin

Polyptyque d’Irminon

Censier de l’abbaye de Sainte-Geneviève
1.2 Vers une généralisation progressive des patronymes
Dans l’Europe chrétienne, les différentes prescriptions de l’Eglise faisant suite au Concile de Trente (1545-1563), les ordonnances royales en France (Villers-Cotterêts en 1539, Blois en 1579) vont marquer des étapes importantes. Peu à peu, les noms de famille deviennent plus stables et transmissibles. Mais la transition est longue et, selon les régions ou les contextes, de nombreux individus apparaissent encore sans patronyme.
On rencontre notamment :
- des enfants trouvés, inscrits comme « anonymes » ;
- des domestiques ou populations marginalisées, identifiés par leur seule fonction ;
- des étrangers ou esclaves, mentionnés sans filiation.
1.3 De l’état civil révolutionnaire à la normalisation du nom
La Révolution et l’instauration de l’état civil en 1792 imposent le nom de famille à tous les citoyens. Pourtant, des cas particuliers subsistent : enfants abandonnés à qui l’on attribue un nom arbitraire, esclaves affranchis dans les colonies recevant un patronyme administratif, ou encore étrangers naturalisés dont l’identité évolue lors de leur intégration.
📌 Référence : Code civil – Livre I, Titre II : Actes de l’état civil
II. Méthodes pour retrouver un ancêtre sans nom de famille
2.1 Observer les prénoms et sobriquets
Les prénoms, surtout lorsqu’ils sont rares, constituent un indice fort. Les variantes orthographiques exigent une certaine maîtrise de la paléographie. Les surnoms liés à une caractéristique physique ou à une activité professionnelle peuvent également orienter les recherches.
📌 Ressource : Éléments de paléographie (Natalis de Wailly, 1838) – Gallica (BnF)
2.2 Examiner le rôle des témoins et des parrains/marraines
Dans les registres paroissiaux ou d’état civil, les signatures des témoins, parrains et marraines ouvrent souvent des pistes. Leurs liens de parenté ou de voisinage peuvent révéler l’identité manquante.
📌 Exemple (outil) : État civil de Paris – consultation des actes
2.3 Explorer les archives complémentaires
- Hospices et orphelinats : registres détaillant abandons et signes distinctifs. → Enfants assistés – Archives de Paris
- Archives judiciaires : tutelles, adoptions, procès. → FranceArchives – Archives judiciaires
- Archives notariales : contrats d’apprentissage, mariages. → FranceArchives – Archives notariales
- Registres militaires : matricules donnant un patronyme attribué. → Mémoire des hommes – registres matricules
2.4 Analyser les indices matériels et linguistiques
Les noms choisis par l’administration reflètent souvent un contexte : calendrier des saints, toponymie locale, métiers ou conditions particulières.
📌 Ressources : Ressources Toponymie – CNIG ; Charte de toponymie – IGN (PDF)
2.5 Croiser et élargir les sources
La clé reste le croisement : reconstituer une chronologie d’indices (prénoms, témoins, lieux), puis l’élargir aux registres fiscaux, cadastraux ou militaires.
📌 Astuce : FranceArchives – État civil numérisé
III. Cas particuliers et ouverture internationale
3.1 Enfants trouvés et abandonnés
Souvent inscrits comme « anonymes », ils pouvaient recevoir un objet ou signe distinctif mentionné dans les registres. Les archives départementales conservent des fonds riches sur ce sujet.
📌 Resources :

Enfants assistés

Enfants assistés (Gironde)
3.2 Populations esclavisées et coloniales
Les esclaves affranchis recevaient parfois un nom attribué sans lien avec leurs origines. Ces mentions figurent dans les fonds coloniaux.
📌 Resources :

ANOM – portail de recherche

Présentation des ANOM e
3.3 Minorités et migrations
- Juifs : noms imposés ou fixés par décret. → FranceArchives – Décrets de naturalisation 1883-1948 ; Archives nationales – Dossiers de naturalisation
- Tsiganes : souvent identifiés par prénoms ou surnoms collectifs.
- Migrants italiens ou espagnols : variations liées à la langue ou au scribe. → Histoire immigrations
3.4 Regards Européens
| Pays | Particularités | Références |
| Espagne | Double nom (père + mère) au XIXe siècle | Onomástica – Cervantes Virtual |
| Italie | Enfants trouvés avec « nom de couvent » | SIUSA – Sistema informativo archivi |
| Pays nordiques | Patronymes variables selon la génération | Riksarkivet – English |
| Pays nordiques | bis | Riksarkivet – Genealogy |
Conclusion
Chercher un ancêtre dépourvu de nom de famille oblige à élargir le regard. Loin d’être un obstacle définitif, c’est une invitation à croiser les sources, à lire autrement les registres et à replacer chaque indice dans son contexte historique. Les généalogistes trouvent alors, dans l’absence même de nom, un déclencheur d’enquête fécond.
📌 10 pistes essentielles pour vos recherches :
- Relever tous les prénoms et leurs variantes.
- Étudier témoins, parrains et marraines.
- Consulter les registres d’hospices et d’orphelinats.
- Explorer les archives judiciaires.
- Examiner les archives notariales.
- Vérifier les registres militaires.
- Croiser avec registres fiscaux et cadastraux.
- Analyser les surnoms et toponymes.
- Étudier les minorités et migrations.
- Comparer avec les pratiques internationales.